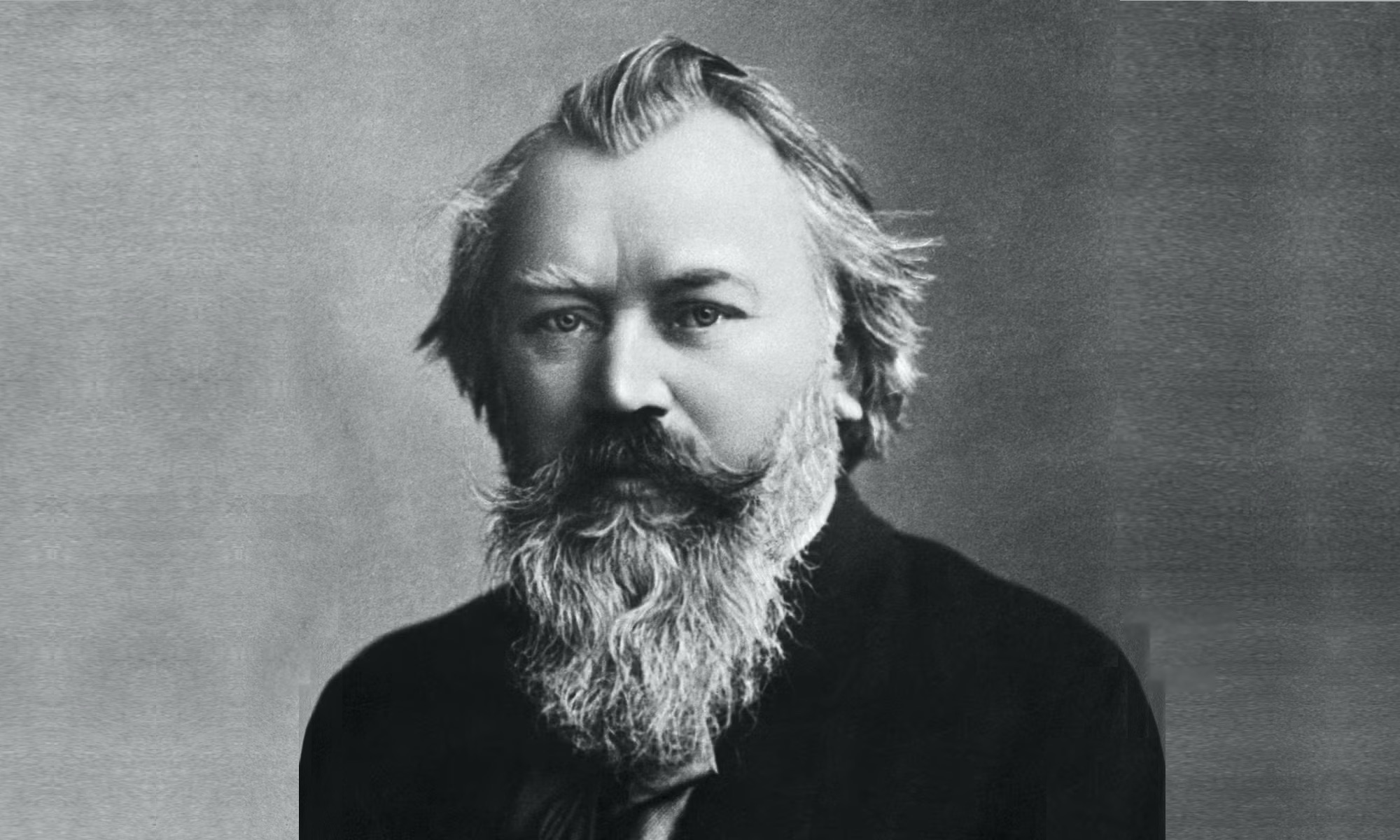Concert de Clôture
Description
Depuis le 16ème siècle, la « Fantaisie » musicale est quasi synonyme d’improvisation. Changements libres de tempo, formes aux contours peu définis et libres de structure, discours déployés sur le vif, au gré du contact avec l’instrument : « on l’invente en l’exécutant », précise l’article de l’Encyclopédie (Diderot et d’Alembert), et « elle n’existe plus quand elle est achevée […] car sitôt qu’elle est écrite ou répétée ce n’est plus une fantaisie mais une pièce ordinaire ». La Fantaisie pour piano à quatre mains de Schubert semble être très éloignée de cette tradition. Mozart et Beethoven, déjà, en avait infléchi le principe. Leurs Fantaisies sont, de fait, intégralement écrites et rigoureusement composées. Il ne reste de l’esprit de « fantaisie » qu’une idée d’improvisation, un style de composition qui fait émerger peu à peu ses motifs, comme si tout s’inventait sur le vif, tandis que des contrastes extrêmes donnent l’impression que la forme se déploie au gré de l’humeur et sans exigence préalable d’architecture. Ainsi l’improvisation est-elle devenue dès la fin du 18ème siècle une manière d’écriture, qui suscite l’effet d’une invention immédiate et l’illusion que tout se produit à l’instrument, sans reprise et sans élaboration ultérieure. Mais avec Schubert, l’inflexion va beaucoup plus loin. Et on peut même aller jusqu’à dire que cette Fantaisie (1828) est l’une de ses œuvres pour clavier les plus élaborées. De fait, la forme est sans relâche, sans flottement ni digressions, beaucoup plus dirigée et cohérente que bien de ses formes sonate. Et pourtant elle ne trahit en rien l’esprit de la Fantaisie. Car Schubert a retenu un élément essentiel de l’improvisation qui présidait aux anciennes fantaisies : l’idée d’une temporalité inéluctable, c’est-à-dire l’idée que la structure formelle ne prend jamais le dessus pour imprimer sa logique propre et l’autonomie de sa durée, mais qu’elle est partie prenante du temps qui passe, qu’elle le subit et qu’elle ne peut pas avoir prise sur lui. C’est là tout le paradoxe de cette œuvre. À certains endroits, elle semble être plus « beethovénienne » que bien d’autres formes de Schubert ; et pourtant, même là où elle prend l’allure la plus décidée, où elle semble aller droit à son but, elle rompt radicalement avec le temps beethovénien, et elle nous fait entendre qu’il ne sert à rien de lutter. Même l’écriture la mieux articulée, les idées musicales les mieux intégrées à la totalité, n’y peuvent rien : le temps passe, et aucune autorité musicale ne peut le faire oublier. Rien de ce qui s’élabore dans la durée musicale n’échappe à cette loi de l’éphémère, et toute prétention inverse est condamnée à l’échec. C’est pourquoi les différentes séquences de cette Fantaisie, nettement différenciées et pourtant reliées entre elles par une logique souterraine, s’enchaînent de manière très singulière. Elles ont l’air de découler l’une de l’autre et leur juxtaposition n’a rien de capricieux ; une véritable nécessité organique les relie entre elles. Mais jamais une nouvelle idée n’a l’air de développer la précédente, de la prolonger, de l’intensifier, ou même de s’y opposer. Le passage d’une idée musicale à l’autre relève toujours de l’inflexion (de la modulation, du changement d’éclairage, de la réponse plutôt que de l’opposition dynamique). Tout se passe donc comme si le discours ne pouvait avancer qu’au gré de ces changements de couleurs, jamais avec la rigueur (beethovénienne) de la démonstration. Ainsi le contraste, chez Schubert, vaut pour pur contraste, jamais pour développement dialectique, ni pour saute capricieuse d’humeur. Et même la « fugue » finale admet qu’elle ne peut pas aboutir. Même sa tension et sa « course » sont vaines. Elle ne peut donc s’achever qu’en se heurtant à un silence, comme si la musique à la fin rendait les armes devant une durée qui n’est pas tout à fait la sienne, et qui l’empêche de faire comme si la conclusion ne dépendait que de son pouvoir d’élaboration. Même le premier thème a cette double valeur. Le motif d’accompagnement lui donne une pulsation intérieure très rigoureuse. Les silences de la basses, l’allègement de la réalisation à la main droite y contribuent très bien : ce thème avance, dans un tempo qui n’a rien d’une rêverie suspensive, Allegro molto moderato. Les appoggiatures de la mélodie y contribuent tout autant ; le phrasé est tendu, et Schubert prend garde à ce que jamais son thème ne puisse s’affaisser sur les temps forts de la mesure. La ligne se tend et le thème commence à moduler. Il pourrait initier sa transformation interne, et s’ouvrir ainsi vers de nouvelles élaborations, vers ses différences. Mais il n’avance que vers son silence – et les longs silences, dans cette Fantaisie, sont nombreux. Ce thème, qui avance mais qui n’a pourtant pas de but, ne peut donc que changer d’éclairage, du mineur au majeur. Avec cette sensation si particulière à Schubert : parce que le Majeur n’aboutit rien, et parce qu’il se fait entendre à l’endroit même où la forme renonce à se développer (à s’intensifier, à construire sa progression), il devient plus triste encore que le mode mineur. Il y a dans ce mode majeur comme une résignation, quelque chose d’un sourire sans joie ni prétention, comme le sourire qu’on lirait sur le visage de celui qui a la sagesse d’abandonner et qui accepte modestement sa défaite. Quelques mesures plus loin, la Fantaisie change de ton. L’écriture se fait plus puissante, et le rythme pointé du commencement prend une nouvelle valeur, presque volontaire. Mais là encore : parce que cette ouverture de la forme sur sa tension n’est pas réellement préparée, parce qu’elle ne résulte pas de ce qui précède et qu’elle ne fait qu’y répondre, nous entendons d’emblée ce qu’il y a de désespéré dans la puissance de ses sonorités. Rien ne s’élargit à proprement parler dans ces mesures aux accents forts, et l’énergie ainsi manifestée ne pourra que se replier aussi vite qu’elle est apparue. Et il en ira de même pour toutes les transitions. Partout le discours musical aura l’air de vouloir gagner la logique de ses enchaînements, progresser, élaborer, aboutir. Mais à chaque fois l’élan devra se résoudre en silence. Une Fantaisie purement capricieuse pourrait célébrer les pouvoirs de l’imagination, sa victoire sur la logique discursive et intégrative de la structure. Elle pourrait manifester la toute-puissance de l’humeur ou du rêve. Schubert n’a pas cette complaisance. Il nous fait entendre que toute maîtrise – maîtrise de la durée ou maîtrise de l’instant – est illusoire. L’autre paradoxe de cette Fantaisie tient à son écriture pour piano à quatre mains. Schubert affectionnait cette disposition rapprochée des pianistes au clavier. Elle était propice à ces rencontres entre amis (et amies) que déjà dans son temps on nommait « schubertiades ». Bien des gravures ont rendu compte de l’atmosphère qui régnait dans son cercle amical : l’échange complice, la musique par proximité, l’intimité bienveillante du salon, sans l’emphase du grand concert. Mais cette Fantaisie va au-delà de ce cadre. Et contrairement à nombre de ses œuvres à quatre mains, l’esprit convivial du salon fait place à une sonorité d’un autre type, plus ample et presque voisine du quatuor à cordes. Si ce n’est que l’écriture pour piano à quatre mains fait entendre sa limite, car l’écriture vient parfois saturer le clavier. Or c’est cette limite en elle-même qui est expressive, et qui participe aussi de cette tension qui traverse l’écriture formelle. Il suffit d’entendre les transcriptions de cette Fantaisie pour piano seul ou pour piano et orchestre : le charme aussitôt disparaît, et une gêne s’installerait presque. Car le piano à quatre mains permet à Schubert de faire sonner quelque chose qu’aucun autre effectif ne saurait faire entendre : ce mélange d’intimité partagée, de chant en commun, et d’élans impossibles, ce va-et-vient entre la voix simple d’une phrase que l’on prononcerait entre amis et la masse sonore contrariée d’un désespoir qui, d’échecs en renoncements, ne peut être que solitaire. Verena Meyer La 5eme sonate de Beethoven La 5eme sonate de Beethoven opus 102 n2 est la dernière d’un cycle de sonates pour violoncelle et piano qui s’étend entre 1796 et 1815. Les violoncellistes ont la chance de pouvoir, avec seulement 5 sonates, couvrir les 3 grandes périodes créatrices de Beethoven. Bien que « Beethoven ait toujours été Beethoven » ont peut s’accorder à dire que, vivant de 1770 à 1827, il a été autant témoin qu’acteur du passage du classicisme au romantisme. Comme élève (très turbulent) de Joseph Haydn, il maîtrise les formes classiques et s’ingénie déjà à les tordre à volonté. Ensuite, emporté par la vague « Sturm und Drang », au tournant du siècle, il écrit les plus belles pages romantiques qui soient. Et, autour des années 1815, après une période étonnement stérile, il ouvre la porte d’un style ultime qui ne cesse de surprendre et émouvoir. Cette sonate opus 102 n2 est avant tout un chef d’œuvre d’invention et d’émotion. Le 1er mouvement est d’ une liberté totale de forme, avec des thèmes très courts qui s’enchaînent parfois sans transition et des contrastes très marqués. Le 2eme mouvement, un adagio qui touche au sublime par la longueur de ses phrases, un lyrisme permanent, une palette d’émotions allant du plus profond désespoir à la plus grande félicité, de ces musiques qui sont traversées par un souffle spirituel. On trouvera des pages similaires dans la 9eme Symphonie, la sonate « Hammerklavier » ou la Missa Solemnis. À la fin de ce mouvement, la musique se raréfie, tend vers le silence, se meurt pour donner naissance au 3eme mouvement: une fugue. La fugue tient la plus grande place dans la production du dernier Beethoven; il s’agit de la technique de composition la plus élaborée de la musique qui consiste à faire cohabiter des thèmes tout en leur laissant leur autonomie. Cet art du contrepoint dont Jean-Sebastien Bach était le champion, était tombé en relative désuétude depuis le milieu du XVIIIeme siècle, l’esprit de l’époque s’accordant mal à la rigueur cérébrale de la fugue. Beethoven s’en empare et en pousse la technique à son paroxysme dans la « Grande Fugue » op 133 dont Stravinsky disait: « une musique contemporaine, contemporaine pour toujours » Certes, le compositeur semble bien s’amuser à élaborer sa structure complexe, mais qu’en est-il de l’auditeur? Le grand plaisir à l’écoute de la fugue est d’abord de sentir le puzzle se former en direct, de suivre les thèmes passer d’une voix à l’autre, mais surtout de ressentir l’énergie qui se dégage de cette élaboration progressive; Une fugue, en particulier chez Beethoven ne peut pas laisser indifférent. Notre 5eme sonate est remarquable dans le sens où elle est l’une des premières œuvres reflétant tous les aspects du dernier style Beethovennien. Ainsi, a posteriori, on a pu dégager des lignes directrices dans la production de Beethoven en évoquant 1,2 ou 3 manières. Néanmoins, Beethoven n’a jamais cessé d’être lui même; un esprit ultra moderniste, un génie de la composition mais qui a su toucher tous les publics et un homme qui, bien que traversé par les drames les plus profonds, n’a jamais cessé d’exprimer la joie ni de croire en la fraternité humaine. Un vrai héros romantique.
Programme
F. Schubert
Fantaisie pour piano à quatre mains en fa mineurJean-Frédéric Neuburger et Victor Demarquette, pianoL. v. Beethoven
Sonate n. 5 pour violoncelle et pianoHenri Demarquette, violoncelle ; Jean-Frédéric Neuburger, pianoJ. Brahms
Quintette pour piano et cordes en fa mineur Op. 34Kerson Leong et Daniel Neuburger, violon ; Paul Zientara, alto ; Henri Demarquette, violoncelle ; Victor Demarquette, piano